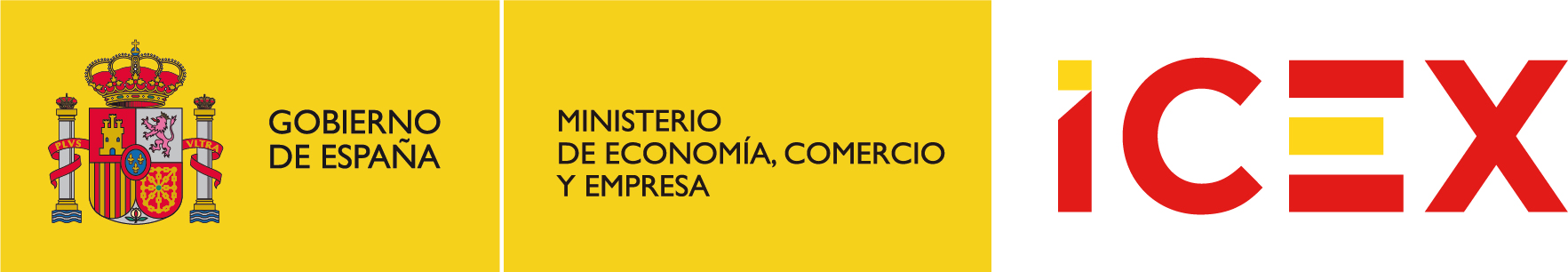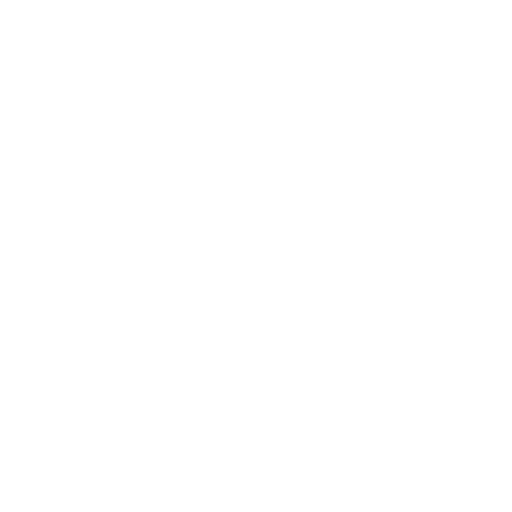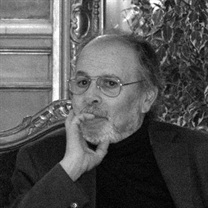
Albert Bensoussan, qui est né en 1935 à Alger, s’établit en France en tant que professeur d'Espagnol après l'indépendance de l’Algérie et devient rapidement l'un des principaux experts de la littérature latino-américaine de l’Hexagone. Pendant les années 1963 à 1995, il donne des cours à la Sorbonne et à l'Université de Rennes.
Traducteur entre autres de Guillermo Cabrera Infante et de Juan Carlos Onetti, il est surtout connu pour sa fidélité à Vargas Llosa dont il est le traducteur depuis plus de quarante ans.
Écrire l’Auteur, décrire l’Autreu :
Guillermo Cabrera Infante et moi
Traduire est un acte d’adhésion à l’auteur. Un mouvement de l’esprit qui commande à la plume et celle-ci se soumet et vibre vers l’empathie – ou disons vers l’identification à l’autre. Si je reviens à mes premiers livres de traducteur, en 1970 je vois bien que ce n’était que mouvements du cœur alliés aux sortilèges de l’esprit. Il faut dire que pour mon coup d’essai (hormis quelques gribouillages antérieurs) fut la traduction d’un chef d’œuvre absolu : Trois tristes tigres, de Guillermo Cabrera Infante. Je ne savais rien de cet écrivain, et pas grand chose de Cuba, tout juste le déjà lointain souvenir de l’épopée fidélienne ou du fiasco de la Baie des Cochons. Mais du jour où je pénétrai dans son être – et ses êtres : je veux dire sa demeure – ma vie fut transformée.
Je me revois sur le dur bois du bahut sur lequel je dormais, enveloppé d'une méchante laine, le front entortillé pour faire écran à la lumière londonienne du trottoir qui entre à flots par la baie ¾ bow window, bof ! ¾, des boules de cire au fond des oreilles pour accompagner Ulysse jusqu'à Ithaque, sans entendre la sirène des firemen. M’interrompant, me coupant pour quelques heures de repos, retranché avant cette aube où le tigre s'éveillant viendrait happer d'une griffe mâle ma pauvre tête fêlée de traditeur / traditore : Trahissons, bon sang ! et déjà Miriam l'épouse accomplie et dévouée apportait le premier des treize cafés qui rythmeraient la journée et amèneraient l'esprit à la limite extrême de l'éveil, à l'acuité, à la pointe. Cela, et le tabac. On appelle tabac / tabaco à La Havane la feuille que roula autrefois Miriam sur ses cuisses blanches qu’elle exhibait d'un geste vif en remontant du genou et me montrant quel art fut le sien dans l'ancien temps de la cigarière : Holy Smoke. C’est le dernier livre de Cabrera que j’ai traduit. Mais revenons à la Genèse – et qu’on me permette cette majuscule : pour moi, ce fut temps de Création.
On admet aujourd’hui, plus de quarante ans après, que Trois tristes tigres représenta une révolution ¾ une autre révolution cubaine ! ¾ de l’art et de l’écriture du roman. Publié en 1965 à Barcelone ¾ après avoir été couronné du prix Biblioteca Breve ¾ et en 1970 en traduction française (Prix du Meilleur Livre Étranger), le chef-d’œuvre de Guillermo Cabrera Infante est considéré comme le roman de la parole qui se défait, de la voix qui se décompose, du verbe en délire, de la littérature en faillite, du roman mis en pièces. Le roman aussi de La Havane dévastée, et la pièce maîtresse de la littérature de l’exil. À mille lieues des littératures latino-américaines du moment, encore fortement marquées par l’indigénisme, avec les traits archaïques d’un réalisme folklorique frappé au sceau d’une idéologie vaguement socialisante, dont je découvrirais la critique définitive en traduisant de mon cher Mario Vargas Llosa L’utopie archaïque – José María Arguedas et les fictions de l'indigénisme, en 1996.
J’ai eu l’honneur redoutable de traduire Guillermo Cabrera Infante, et pour ce faire il m’a fallu à deux reprises me rendre à Londres, et résider durablement dans ce lieu d’exil de l’écrivain cubain, devenu, depuis, citoyen de Sa Gracieuse Majesté. J’ai, donc, vécu chez lui plusieurs semaines, dormi sur le canapé du salon éclairé a giorno par les lampadaires de Gloucester Road, partagé ses repas (arroz cubana, tostones de banane plantain et cuba libre), travaillé avec lui jour et nuit - de 9 heures du matin à 3 heures de l'aube suivante, à l'exception du Jour du Seigneur scrupuleusement respecté par le Mage. Et je m’y suis épuisé. Mais il m’en reste le souvenir et la mémoire de nos trouvailles, de nos trucs d’écriture, de nos tics, de nos bonheurs.
Ce n’était pas une traduction ordinaire, puisqu’il s’agissait d’un livre extraordinaire, et j’avoue n’être rien sans lui, n’avoir rien pu faire de ma seule initiative, car j’ai toujours pu compter sur ses patientes explications ou ses suggestions. En le voyant vivre avec Miriam, sa femme, et aussi les deux petites, Ana et Carola, sans parler d’Offenbach le chat siamois (dont je traduirais ensuite la chronique dans un fameux chapitre ¾ « Jaime Diego Jacobo Yago Santiago Offenbach » ¾ de Orbis oscillantis, en 1976), j’ai, peut-être, compris le fonctionnement de son œuvre, en aucun cas dissociable de sa personne. Voilà ce que j’ai appris de lui : Une œuvre n’est pas séparable de son créateur, et le traducteur, s’il veut accéder à cette empathie qui lui permettra de mieux restituer l’original, doit aussi entrer dans l’intimité de l’auteur, et partager son quotidien.
Comme tous les grands humoristes, Cabrera Infante est d’un sérieux imperturbable, d’autant plus pince-sans-rire que le voilà tout à fait british, et c’est dans la gravité que tous ces jeux sur le langage ont été analysés et traduits. Je dirais, néanmoins, que le rire était toujours noyé dans la sueur de l’effort. Que n’ai-je ri et sué en inventant ces noms fantaisistes qui traduisaient toujours l’intention démolissante de l’auteur, comme ce procédé qui fait passer la danseuse nationale de Cuba Alicia Alonso au patronyme russifié d’Alonsova, traduisant à la fois un talent reconnu et la contamination soviétique de la culture cubaine ! Eh bien, dans sa foulée, j’ai risqué cette énormité d’avoir appelé – et noblement russifié - le plus grand danseur français du moment : Boris Méjart (Maurice Béjart). Et nous avons noyé notre fou rire dans la fumée, lui de son H.Upmann (qu’il appelait « Ecce Homo » !), moi dans ma Gauloise bleue. Cabrera m’a appris à avoir de l’audace, à ne pas être ce scribe accroupi qui traduit littéralement – et donc mal, parce qu’il passe à côté de tant d’intentions malignes de l’auteur facétieux.
Ainsi cet exemple sur l’océan Caraïbe, cet azuloso mar porcelado (¿o se dice azulado mar proceloso ?), ce balbutiement malicieux que j’ai traduit hardiment – il se penchait sur moi pour me pousser à bout : les fleus blots furieux (ou dit-on les flots bleus furieux ?), avec le même effet de métathèse dans ce jeu langagier où l’on estropie d’abord, puis on rectifie entre parenthèses ; on a l’air de bafouiller, de se tromper, pour se rattraper après, ce qui donne une étonnante vigueur à la phrase.
Ou cette parodie des écrivains : celle de Lydia Cabrera qui met en équation comique la santería cubaine et tout le vocabulaire pseudo-africain, qui mêle vrais dieux et fausses expressions dans un jeu / feu continu de parenthèses ou apartés : « que estaba bien (tshévere) - que c’était bien (Fo’mido), estaba también de acuerdo (sisibuto) - était également d’accord (béni-oui-oui), Olofi ta contento - Olofi lé content, et culminante : « ¡Qué situación difícil ! No (nananina) quedaba (re’tongo) más (ma) remedio (iwo finda) que (ke) irse (futé-le-kán) - Quelle situation difficile ! Il ne (nenni) restait (restongo) d’autre (otrogo) solution (iwo finda) que (ke) de s’en aller (fouté-le-kan) » (si l’on arrive à me suivre !). Sans oublier les notes comiques, et celle qu’ajoute le traducteur à coco traduit par Cabosha (= caboche) : « Coco en cubain. Du polynésien Tateete », où l’amour de Gauguin pousse le traducteur à s’inspirer du célèbre tableau Ta matete ¾ le marché ¾ amalgamé au toponyme Papeete, afin d’aboutir à la « tête », qui est caboche ou coco. Traduire ce genre de texte parodique cause toujours un plaisir intense au traducteur qui se voit, ici, légitimé en tant que créateur (malgré les réserves de Milan Kundera à l’égard d’un traducteur qui voudrait être le rival de l’auteur).
Je terminerai cette note par la logorrhée caractéristique de Cabrera Infante, cette accumulation de paronomases à effet comique, dont on a deux exemples : le premier joue du titre de l’ouvrage emblématique Alice au pays des merveilles, le second, du nom de l’ami qui prend le masque de Boustrophédon, Rine Leal, et il se permet toutes les acrobaties dans la paraphrase des deux noms. Le traducteur n’a pas dans ce cas à traduire servilement mais à entrer dans le jeu de la cohue langagière et à se laisser aller en toute fantaisie (« Lâche-toi », me disait Guillermo, en cubain, bien sûr) :
Alicia en el mar de villas, Alicia en el País que Más Brilla, Alicia en el Cine Maravillas, Avaricia en el País de las Malavillas, Malavidas, Mavaricia, Marivia, Malicia, Milicia Milhizia Milhinda Milindia Milinda Malanda Malasia Malesia Maleza Maldicia Malisa Alisia Alivia Aluvia Alluvia Alevilla y marlisa y marbrilla y maldevilla
que j’ai “traduit” (si l’on peut dire) de la sorte :
Alice au pays des mers vieilles, Alice au pays d’amère veille, Alice au palais des males vieilles, Males vies, Mal vice, Malalice, Malice, Milice Mifigue Mirisin Maraisin Maraison Malaisance Malaisie Malaise Alaise Alésia Arlésia Arlésienne Alesbienne Alèsriendenouveau ¾ l’introduction de « Alesbienne » fait écho au jeu récurrent sur le personnage de Beba Longoria, ailleurs appelée « Lesbica Beba ».
Puis le jeu sur Rine Leal et Bustrófedon aboutit à cet autre effet accumulatif :
Rineceronte, Rinedocente, Rinedecente, Rinecente, como luego hubo un Rinecimiento seguido de Rinesimiento, Rinesimento, Rinesemento, Rinefermento, Rinefermoso, Rineferonte, Ronoferante, Bonoferviente, Buenofarniente, Busnofedante, Bustopedante, Bustofedonte
devenu en parfaite fantaisie :
Rhinecéros,Rhinecerveau, Rhumedecerveau, comme il y a eu ensuite un Rinaissant suivi du Rinaissance, Rinaisance, Rinefossedaisance, Rinefervent, Rinefervolant, Roneffervescent, Roneofarniente, Buonofarniente, BusnofaiDante, Bustopédante, Bustopétant, Bustopétard, Bustofêtard, Bustoféerique, Bustoféroce.
Pas question dans cet exercice de rechercher une quelconque littéralité, ou quelque adéquation des signes. Une fois admis le jeu, et démonté son fonctionnement, le traducteur n’a qu’à laisser couler. Dans ce cas-là, qui peut lui contester le rôle de créateur ? (Kundera, peut-être, avec un brin de mauvaise foi, dans ses Testaments trahis.) À ma question sur cette littérature “jacassière” (ainsi disais-je), Cabrera m’a répondu un jour, avec infiniment de tristesse, malgré la malice de ses petits yeux bridés : « TTT est un livre loquace par et pour des gens loquaces, qui célèbre un peuple loquace en train de disparaître dans le laconisme ».Trois tristes tigres est le seul roman, à ma connaissance, à poser la problématique de la traduction, dans son double chapitre de Mrs. Campbell, où l’on a d’abord un texte achevé, puis le brouillon non corrigé du traducteur. On pourra utilement comparer, dans le roman et sa traduction, les deux versions successives, la bonne suivie de la mauvaise. Mais c’est évidemment le brouillon supposé du mauvais traducteur d’un texte anglais prétendument original, qui retient toute l’attention. Ce que censure l’auteur chez le traducteur ¾ qui en prend plein le mufle au moment où il exerce ses talents ¾ c’est son littéralisme, bien sûr, avec des phrases aussi grotesquement calquées sur l’anglais que la infestada de mosquitos, endémica con malaria, poblada por bosques de lluvia Zona Tórrida - l’infestée de moustiques, endémique de malaria, peuplée de forêts de pluie Zone Torride. Il est clair que la traduction en français doit obéir ici à cet impératif : plus c’est mauvais, mieux c’est. Alors le traducteur s’en donne à cœur joie, dans tous les anglicismes outranciers (« Miel [traduisant un supposé Honey = Chéri], c’est le Tropique ! »). On notera l’accumulation de notes explicatives, dont on sait qu’elles sont la honte du traducteur. Ce pourquoi, hormis ce chapitre, Cabrera m’a interdit à tout jamais de mettre des notes de bas de page, la pire étant, à ses yeux, d’écrire « jeu de mot intraduisible », qui ajoute à l’incompréhension du lecteur sa frustration. Le traducteur a ici, en tout cas, manifesté sa passion et son plaisir d’écrire. Et de créer.
Guillermo Cabrera Infante a été mon tuteur, mon introducteur et mon parrain au Temple de la Traduction. C’est chez lui, à Londres, que j’ai connu les autres futures gloires à qui j’allais bientôt prêter ma plume et ma voix. Par lui, j’ai rencontré Manuel Puig, dont j’ai traduit – roman et pièce – Le baiser de la femme-araignée et tout ce qui a suivi. Par lui, surtout, que j’allais rencontrer l’immense Mario Vargas Llosa, dont j’ai tout traduit depuis 1971 (quand j’entrepris ses Chiots / Cachorros), toute cette œuvre immense, d’une quarantaine de titres, qui allait culminer en 2010 sur le prix Nobel – dont j’ai traduit, bien sûr, le discours de Stockholm. Et j’ai prêté ma voix aussi aux amis de ce dernier, José Donoso et Juan Carlos Onetti. Et, pour en rester encore à Cuba et à tant de gusanos mis au banc d’un régime détestable : Heberto Padilla, dont l’incarcération émut le monde entier dans les années soixante-dix, et, last but not least (comme dirait G. Ca-In, Esquire) ma chère Zoé Valdés qui, mieux qu’aucun autre, a su nous transmettre le drame et la douleur de l’exil. Que n’ai-je traduit ! Qui n’ai-je traduit ? Mais rien n’aurait pu se faire sans la main qui m’a bénie, celle de cet écrivain primordial et majeur que, dans mon essai sur les lettes latino-américaines : Retour des Caravelles, j’ai surnommé, en mimant son rire : « The captain Ahab of the Malecón » !
Albert Bensoussan
Qui sommes-nous?
Thierry Clermont est journaliste au Figaro littéraire depuis 2005. Il a été membre de la commission poésie du Centre national du livre....
SUITE
Interview
Diplômé de l'École Normale Supérieure et spécialiste des lettres modernes, de l'espagnol et de l'anglais, Clément Ribes....
SUITE
Rechercher
Catégorie

QUI SOMMES-NOUS?
Bienvenue sur le site de New Spanish Books, un guide des...