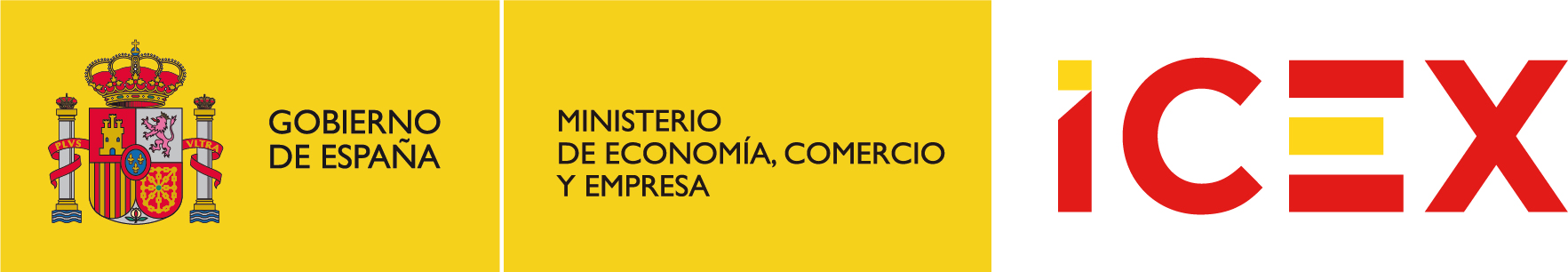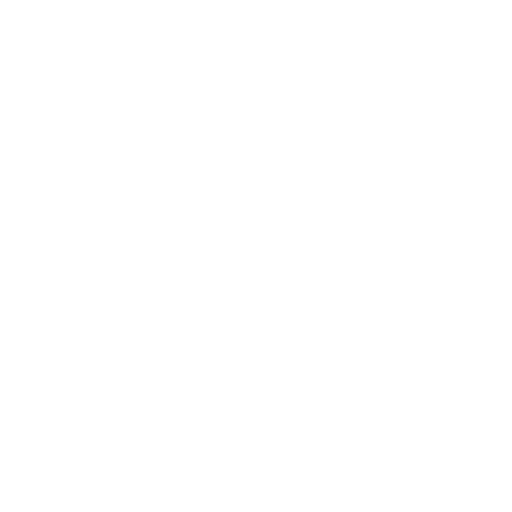INTERVIEW
INTERVIEWS ANTÉRIEURES

Diplômé de l'École Normale Supérieure et spécialiste des lettres modernes, de l'espagnol et de l'anglais, Clément Ribes, 33 ans, a enseigné le français à l'Université de Harvard avant de devenir éditeur aux Éditions de L'Olivier.
Il a été nommé directeur éditorial de Christian Bourgois Editeur en septembre 2019.
En 2021, il quitte Christian Bourgois éditeur pour rejoindre Gallimard, où il est en charge d'un nouveau imprint: " Scribes ".
Francesca Mantovani / Gallimard
Comment êtes-vous entré dans le monde de l’édition ?
Mon parcours est somme toute assez classique : après des études de lettres à l’École normale supérieure, ne voulant pas entamer une carrière dans l’enseignement, j’ai commencé à faire des stages dans l’édition. J’ai d’abord passé six mois aux éditions du Seuil au service des sciences humaines, où je m’occupais avant tout de titres d’histoire (Histoire de la virilité, notamment) et de philosophie ; puis quelques mois aux éditions Flammarion au service des manuscrits (littérature) où j’ai été confronté pour la première fois aux quantités énormes d’enveloppes reçues chaque jour par les grandes maisons d’édition. Une fois que mon stage chez Flammarion a pris fin, j’ai envoyé plusieurs candidatures spontanées pour d’autres stages à des éditeurs dont je me sentais proche – par chance, un poste venait de se libérer aux Éditions de l’Olivier, et c’est comme ça que j’ai commencé ma « carrière » dans ce domaine – en tant que coordinateur éditorial.
Auparavant, je n’avais jamais songé sérieusement à travailler dans l’édition : ce n’était ni un but, ni un rêve pour moi. D’abord parce qu’on dit souvent qu’il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus, ensuite parce que, à tort ou à raison, on s’imagine que pour exercer dans ce milieu, il faut avoir des connexions, ou des pistons, et je n’en avais aucun. J’avais d’abord voulu être professeur avant d’abandonner cette idée, puis traducteur – et je suis devenu éditeur au gré des rencontres et des occasions qui se sont présentées.
Comment découvre-t-on un auteur étranger ? Quelle est la motivation qui anime un éditeur à faire traduire un livre ? Quelle est la partie de hasard ? Quel parcours doit suivre un ouvrage pour pouvoir être traduit ?
Il y a de nombreuses façons de découvrir un auteur étranger : par l’envoi spontané que nous fait un agent littéraire (c’est une pratique très courante dans de beaucoup de pays étrangers, moins en France, même si, depuis quelques années, le rôle des agents est de plus en plus important), par les recommandations de scouts (les personnes qui sont payées par les maisons d’édition pour nous informer sur l’actualité littéraire étrangère), ou par celles des traducteurs (en plus d’être des passeurs essentiels des littératures étrangères, nous nouons souvent des liens de confiance avec certains d’entre eux, en particulier pour les langues que nous ne maîtrisons pas), par la fréquentation de librairies quand je suis à l’étranger (en ce qui me concerne, les librairies de New York, Boston, Madrid, surtout) ou, plus « vingt-et-unième siècle », par les nuits d’insomnie que je consacre à errer sur internet et les réseaux sociaux où, de fil en aiguille, un lien en appelant un autre, je découvre souvent l’existence d’auteurs et de textes qui m’interpellent.
Ces façons diverses de rencontrer un texte ne procurent pas toutes la même satisfaction : je dois avouer que je ressens toujours un surcroît de plaisir ou d’enthousiasme dans le cas des librairies ou des réseaux sociaux, car ces deux techniques procurent le plus grand sentiment de hasard. Il s’agit pleinement, dans ces cas-là, d’heureuses rencontres, presque inespérées, lesquelles mettent sur mon chemin des textes dont j’estime peut-être avec un peu d’orgueil qu’ils m’étaient destinés, d’abord en tant que lecteur, ensuite en tant qu’éditeur.
Pour ce qui est de ma motivation à faire traduire un livre, elle tient avant tout à l’enthousiasme que je ressens à la lecture du texte : les éditeurs lisent beaucoup, et on pourrait parfois avoir l’impression d’une lassitude, de ne plus être surpris par rien. Quand un livre me surprend, quand il vient « briser la mer gelée en moi », pour reprendre la formule bien connue de Kafka, je sens qu’il se passe quelque chose. Et je me dis que s’il se passe quelque chose en moi, il est possible que ce texte produise quelque chose chez les autres. C’est ce qui me donne envie de faire traduire un livre dans un premier temps. Ensuite, évidemment, se posent d’autres questions : ce livre vient-il enrichir l’image que nous avons de la littérature de tel ou tel pays ? Comment peut-il parler ou non à un public français ? Représente-t-il, à sa façon, les propositions littéraires à l’œuvre en ce moment dans l’espace culturel où il est né ? Autant d’interrogations qui précisent mon sentiment initial de lecteur, et qui, je l’espère, me guident pour faire les meilleurs choix, ou les plus pertinents.
Ensuite, je fais une offre pour l'achat des droits de publications en langue française, puis vient une partie très délicate et très importante (une de mes préférées) : la quête du traducteur ou de la traductrice. Les traducteurs ne peuvent pas tous traduire tous les livres : chacun a sa sensibilité et ses points forts, et mon rôle en tant qu'éditeur est de bien choisir à qui proposer la traduction d'un texte. Plusieurs critères très différents peuvent être en jeu. Pour donner un exemple qui a trait à l'espagnol, imaginons que je vienne d'acheter les droits d'un roman cubain formidable, plein de cubanismes, de jeux de mots, etc. Je me tournerais spontanément vers un traducteur qui a traduit des auteurs comme Cabrera Infante ou Arenas. C'est un exemple imaginaire. Je peux vous en donner un autre : quand j'étais directeur éditorial de Christian Bourgois éditeur, j'ai acheté les droits de Vivir Abajo, un roman monumental de l'écrivain péruvien Gustavo Faveron Patriau. C'est un roman fait de nombreuses influences, qu'elles proviennent de Sabato, Saenz, ou, de manière assez évidente, Bolaño. C'est pourquoi j'ai proposé à Robert Amutio, qui a traduit la majeure partie de l'oeuvre de Bolaño, de s'atteler à cette tâche – et j'ai été ravi qu'il accepte.
Je crois très fort à cette idée de « couple » entre un auteur et un traducteur – et je pense qu'il est très important qu'un auteur garde le même traducteur pour sa « vie » en français, dans la mesure du possible et des emplois du temps.
Qu’est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la littérature en espagnol?
Mon rapport à la littérature en espagnol est fait d’héritage et d’approfondissement. D’héritage, car la moitié de ma famille est pied-noir d’origine espagnole – en un sens, une partie de moi parlait déjà espagnol quand je suis né, mon nom de famille (même s’il est catalan !) ne laisse aucun doute là-dessus. D’approfondissement, car une fois que j’ai eu pris conscience de cet héritage-là, j’ai développé un goût pour la culture espagnole, puis les cultures latino-américaines qui s’est précisé dans mes études : j’étais ce qu’on appelle un « hispaniste » y compris durant mes années à l’École normale supérieure où j’ai adoré participer à l’atelier de traduction collective que François Géal organisait quand il y était professeur. Avec un groupe de camarades et sous sa direction, nous avons traduit les Prosas Apátridas de Julio Ramon Ribeyro, Miserias y esplendores de la traducción de José Ortega y Gasset, et le Diario de un viaje en París de Ruben Dario – une expérience d’échanges, de débats infinis sur la traduction d’un terme, et de partage autour de la littérature qui m’a beaucoup marqué.
Ensuite, même si mon intérêt pour les littératures hispaniques demeurait intact, je ne l’ai pas exercé dans mon métier d’éditeur : je travaillais aux éditions de l’Olivier, où la littérature étrangère est majoritairement anglo-saxonne, ce qui ne me laissait pas l’occasion d’approfondir ce tropisme. Mon arrivée au poste de directeur éditorial de Christian Bourgois éditeur en 2019 a été, à ce titre, très exaltante : je pouvais de nouveau lire à haute dose ce qui s’écrit en espagnol et publier beaucoup de romans hispaniques en restant fidèle à l’image de cette belle maison qui a tant fait au cours de son histoire pour promouvoir ce domaine linguistique.
Ce qui maintient mon intérêt pour les littératures hispaniques à l'heure actuelle, c'est que je les trouve d'une inventivité assez extraordinaire – en Amérique latine comme en Espagne, nous voyons de jeunes auteurs qui s'emparent du roman ou de la nouvelle pour pousser ces deux genres littéraires dans leurs retranchements, des écrivains qui réinventent la tradition dans laquelle ils s’inscrivent. Il y a une production très étonnante et qui sort constamment des sentiers battus.
Quel est de votre point de vue l’intérêt des lecteurs français pour la littérature et la culture espagnole ? la demande a-t-elle tendance à progresser? Est-il difficile de publier de la littérature hispanophone en France aujourd’hui ?
Nous avons la chance d’avoir en France un lectorat très curieux des autres littératures, et un tissu très riche de librairies qui s’intéressent à, et promeuvent avec un grand enthousiasme, ce que nous éditons : ce n’est pas forcément le cas dans tous les pays, et nous pouvons nous en réjouir. Cela étant dit, les goûts et intérêts des lecteurs sont pour partie imprévisibles, et fluctuent selon les époques : ainsi, certaines littératures peuvent connaître un grand succès à un moment avant que l’intérêt ne s’émousse, et qu’elles soient remplacées, ou éclipsées, par d’autres. Un exemple des dernières années : la vogue (et la « vague ») des polars scandinaves.
La seule constante est l’hégémonie parfois épuisante du roman états-uniens, comme si nous accordions inconsciemment à la littérature états-unienne une présomption d'universalité, là où les productions d’autres pays seraient reléguées au local, au singulier, au particulier.
Je ne suis pas un expert de la réception de la littérature hispanique en France. En tant que professionnel de l'édition, je n'ai un aperçu que sur les dix dernières années. Il me semble qu'il est toujours difficile de vendre de la littérature en espagnol et que le lecteur français est encore à conquérir en la matière (ou à reconquérir perpétuellement). Pourtant, à certaines époques, la littérature hispanique a joui d'un succès certain, au moment de la publication des auteurs du « boom » en France. Même si, depuis, certains auteurs ont tiré leur épingle du jeu (Bolaño, Padura, Sepúlveda pour les Latino-américains ; Marias, Cercas, Vilas plus récemment pour les Espagnols), à mes yeux, une dynamique est encore à créer ou à intensifier pour faire en sorte que les lecteurs français s'attachent de manière plus régulière ou constante à la littérature en espagnol.
Quelles actions pourraient favoriser la traduction de l’espagnol ?
Nous sommes déjà aidés pour traduire depuis l'espagnol : par les soutiens financiers du CNL ou du gouvernement espagnol, qui font beaucoup pour faire vivre la littérature étrangère dans notre pays. S'il y avait une chose supplémentaire à faire, je pense qu'elle devrait porter sur l'image des littératures hispaniques en France. Il faudrait trouver un moyen de présenter la richesse littéraire de ce qui s'écrit en espagnol à l'heure actuelle. S'il m'est permis de rêver un peu, j’imagine un équivalent du formidable festival « Bellas Latinas », mais commun à l’Espagne et aux pays d’Amérique du sud, pourquoi pas à la Maison de l'Amérique latine ? Un peu à l'image de ce qui a été fait pour la littérature nord-américaine avec le festival America de Vincennes, qui connaît un immense et très mérité succès.
Parlez-nous des auteurs (en espagnol) que vous avais édité (Bourgois, Gallimard etc).
Chez Bourgois, j’ai suivi les auteurs publiés auparavant par Christian et Dominique Bourgois, tout en apportant, de temps en temps, une touche personnelle en ajoutant au catalogue déjà riche les œuvres de nouveaux auteurs aux univers plus contemporains.
Pour ce qui est des auteurs « de la maison », j’ai suivi des personnalités aussi diverses que Martin Solares, César Aira, Alan Pauls, Berta Marsé, Andrés Barba, Antonio Ortuño, Gabi Martínez.
Pour ce qui est des « nouveaux arrivants », je suis très fier d’avoir permis à Natalia García Freire, Carlos Fonseca, Maria Gainza, Alejandro Zambra ou Gustavo Faveron Patriau de rejoindre la liste des éditions Bourgois. Uniquement des latino-américains, donc, dont la coexistence témoigne de l’extraordinaire vivacité hétéroclite de ce qui se produit et s’écrit actuellement dans cette partie du monde : un roman néo-gothique où résonnent les échos de Shirley Jackson et Daphné du Maurier (Mortepeau, de Natalia García Freire), une enquête « vila-matasienne » dans le monde de l’art (Maria Gainza), les deux « monstres littéraires » que sont Vivir Abajo de Gustavo Faveron Patriau et Musée Animal de Carlos Fonseca, qui sont comme autant de creusets où se mélangent des influences aussi diverses que celles de Ricardo Piglia, Ernesto Sabato ou Roberto Bolaño – deux romans qui sont, à mon sens, parmi les meilleurs écrits récemment en langue espagnole.
Nouveaux projets ?
Depuis cette année, je m’occupe d’un nouveau label de littérature de Gallimard : « Scribes ». C’est un espace éditorial au volume de publications raisonnables (une dizaine par an) dans lequel je publierai à la fois de la littérature française et étrangère (les deux jambes sur lesquelles j’ai toujours marché). Sans qu’il soit un label uniquement de « laboratoire », je veux y privilégier des titres dans lesquels le souci stylistique et formel est prépondérant, avec beaucoup de nouvelles voix et de traductions du monde entier.
D’ailleurs, Carlos Fonseca, dont j’ai parlé plus haut et que j’avais publié chez Bourgois, a décidé de continuer l’aventure avec moi chez Scribes. Je suis donc très heureux de pouvoir annoncer qu’il sera l’un des premiers auteurs hispaniques du label avec son nouveau roman, Austral, à paraître en 2023.
Quel est votre auteur hispanique préféré ?
Je vais en citer trois : José Donoso, Juan Carlos Onetti, Alejandra Pizarnik.
Recommandez-nous un livre…
Les Crimes exemplaires de Max Aub, qui me fait toujours autant rire (noir) à chaque relecture !
Tapa préférée ?
Pulpo a la gallega.
Votre mot préféré en espagnol ?
Je dirais qu’il y en a deux. Le premier, je l’aime uniquement pour le son, sans aucun lien avec son sens : « reloj ». Le second, bien qu’il soit très vulgaire, est un des mots qu’on emploie le plus souvent : « joder ». Je ne le choisis pas par provocation, mais parce que, paradoxalement, c’est ce mot qui m’a amené à l’espagnol. Quand j’étais enfant, mes grands-parents juraient en espagnol, ou utilisaient cette langue quand ils ne voulaient pas être compris de moi. Être confronté à l’altérité linguistique, à des mots que l’on entend et que l’on ne comprend pas, est une expérience extrêmement frustrante pour un enfant – et du même coup, la meilleure invitation à apprendre une langue. Je me suis mis à dire « joder » au grand dam de mon grand-père, sans comprendre pourquoi l’on m’interdisait cette interjection. Et c’est comme ça que tout a commencé.
Qui sommes-nous?
Thierry Clermont est journaliste au Figaro littéraire depuis 2005. Il a été membre de la commission poésie du Centre national du livre....
SUITE
Interview
Diplômé de l'École Normale Supérieure et spécialiste des lettres modernes, de l'espagnol et de l'anglais, Clément Ribes....
SUITE
Rechercher
Catégorie

QUI SOMMES-NOUS?
Bienvenue sur le site de New Spanish Books, un guide des...