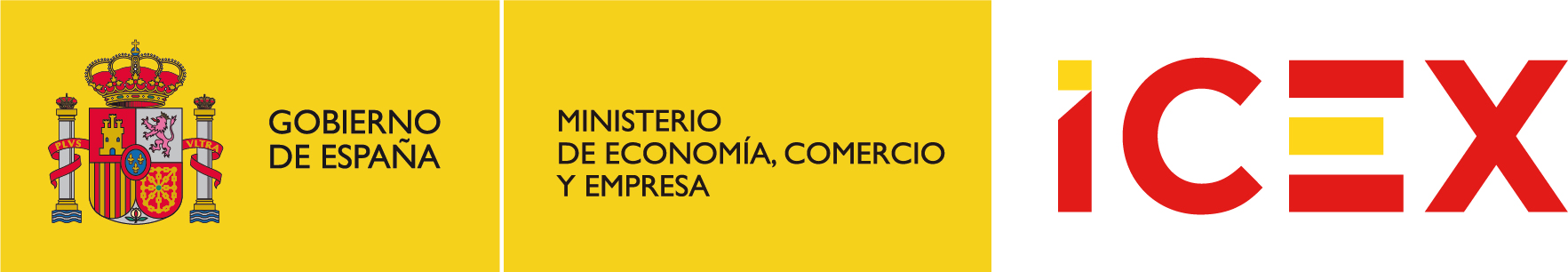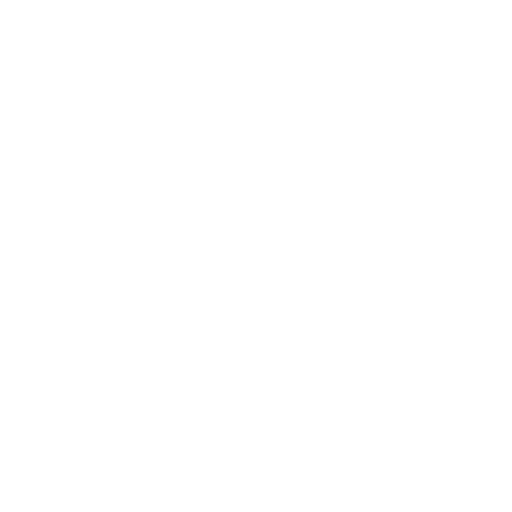Il m’a fallu vingt ans pour lier les étés d’enfance en Espagne et les livres qui ont réveillé et signé leur souvenir. Une langue que j’avais entendue sans la comprendre ni la parler parmi les oliviers et les cyprès, à l’heure de la baignade ou des parties de pétanque, a brusquement refait surface, comme une rivière souterraine passant sous un massif montagneux, les Pyrénées peut-être, à l’occasion d’un reportage à Cuba. Elle n’a plus jamais disparu.
Ainsi a-t-elle suivi en moi, sans que j’en aie conscience, le chemin des conquistadors et de son propre destin littéraire: se renouveler et se révéler à elle-même –et aux autres- par un détour dans ce qu’il était convenu d’appeler le Nouveau Monde et qui, de fait, le devint pour moi en 1993, date de mon premier reportage dans l’île découverte par Christophe Colomb. C’est le détour intérieur d’une langue étrangère qui ne l’est plus. Une langue qu’on s’approprie par le cœur et par le corps est un voyage et un mystère avec un grand trou au milieu. Le trou autour duquel s’est fabriquée ma langue espagnole est sans doute né à quelques kilomètres de la frontière avec l’Espagne, dans ces pauvres villages pyrénéens dont une partie de ma famille est originaire. Il y avait dans l’un d’eux une vue imprenable sur le massif de la Maladeta. La glace a mis vingt ans à fondre et la langue est apparue. Ensuite, son trou s’est déplacé. Il doit désormais se trouver quelque part au milieu de l’Atlantique, au fond d’une eau tropicale. Une langue qu’on s’approprie par le cœur et par le corps devient une Atlantide, on passe son temps à imaginer un monde où l’on aurait pu (ou du) l’habiter. Et c’est à partir de cette imagination qu’on la parle et qu’on en jouit. C’est pourquoi je n’ai aucun rapport professionnel ou commercial à l’espagnol. Il m’est trop cher pour que je le vende au plus offrant.
Dans les années soixante et soixante-dix, j’ai passé la plupart des mois d’août en famille sur la Costa Brava, le long des plages franquistes. Ma mère seule parlait l’espagnol. Elle faisait le lien avec ce monde magique, bruyant, sensuel, où la chaleur était portée par la poussière dans la première moitié d’août, et dans la seconde peu à peu rompue par une succession de violents orages . Les arroyos débordaient, leur couleur café au lait m’enchantait. Il y avait des lauriers roses, des pastèques, des churros, des glaces, des poulets et des aïolis et, sur les plages, des paires de gardes civils dont les tricornes m’attiraient comme à Noël des accessoires de panoplie. Il leur arrivait d’engueuler une femme qui prenait le soleil les seins nus, généralement une Allemande. Ça m’amusait. Tout semblait si bizarre, si exotique. Et je n’aimais pas les Allemands. Ils faisaient du bruit en groupe, indifférents aux autres. Leur physique lourd et leur brutalité alcoolisée me dégoûtaient. Après la mort de Franco, quelqu’un, je ne sais plus qui, m’a parlé de Federico Garcia Lorca et m’a récité ce poème, Chant funèbre pour Ignacio Sanchez Mejias. Le nom et le titre se sont endormis dans un coin de mémoire –et aussi les vers célèbres: A las cinco de la tarde. Eran las cinco y punto de la tarde. Nous allions en famille aux taureaux. Don Angel Peralta toréait à cheval. C’étaient les années de splendeur d’El Cordobès. A peine adolescent, j’ai lu avec passion Où tu porteras mon deuil, le best-seller de Lapierre et Collins, récit de sa vie enluminée. Aucun livre ne mérite la honte d’avoir été lu, s’il a donné du plaisir. Mais beaucoup de livres ne doivent pas plus être relus qu’on ouvre une tombe pour regarder le cadavre de la personne devant qui, une minute ou un peu moins qu’une vie, on se recueille.
J’ai conscience que tout ça relève du folklore, et encore, je me retiens, tant l’enfant vit le folklore que l’adulte dégrade en l’immobilisant. Je pourrais parler longtemps des scènes de Sardane en costumes sur la place arrosée du marché et des spectacles de flamenco que mes parents m’amenaient voir occasionnellement. Cette vieille folle d’Almodovar n’était pas encore passée par là pour nous faire rire et pleurer de tout ça. J’ignorais que Lorca était andalou, homosexuel et qu’il avait été fusillé par des fascistes. Son nom jaillissait des hauts joncs bordant la rivière catalane à San Pedro Pescador (je ne parle pas le Catalan et je me fiche du politiquement correct, j’en reste donc au nom espagnol sous lequel j’ai connu ce village). En contribuant aux plaisirs de l’été, il repoussait les Allemands. Ce qui l’unissait de manière incongrue et somme toute indécente à ceux qui l’avaient tué. Ignorance bénie de l’enfance ! J’ai bien ri quand j’ai lu, vers trente ans, Escena de teniente coronel de la guardia civil. L’humour de Lorca. Ce crétin galonné qui va répétant: Yo soy el teniente. Yo soy el teniente. Yo soy el teniente de la guardia civil. Y no hay quien me desmienta.
Si j’essaie de remonter aux sources physiques du bruissement intime de la langue, je vois d’abord notre arrivée à Rosas, à l’aube, après une nuit de conduite depuis la France pour éviter la chaleur. Mon père garait la voiture sur le port, près du marché aux poissons, avant l’heure de la criée. La mer était calme. Nous sortions de la voiture et l’odeur de l’eau et du poisson m’envahissait au point d’élargir l’horizon. Il faisait encore un peu frais. Les lumières naissantes étaient splendides et métallisées. Les voix rauques nous accueillaient. Nous allions prendre le petit-déjeuner dans le premier café qui ouvrait. Plaisir absolu de l’instant. Plus tard, j’ai lu No eres los otros, ce poème de Borges –dans les œuvres complètes de chez Emecé découvertes à Madrid par un Cubain à queue de cheval qui était jardinier dans la maison luxueuse et de mauvais goût d’un chevalier castillan d’Industrie. Je relis ces vers: Tu materia es el tiempo, el incesante/ Tiempo. Eres cada solitario instante. Sur le port de Rosas, j’étais chaque instant solitaire, et dans chacun de ces instants, dans leur lumière naissante, une langue s’est déposée.
Elle a germé vingt ans après à Cuba, île de ma seconde enfance, mon enfance d’adulte, puis, de là, elle est revenue dans la péninsule, comme Christophe Colomb avec ses Indiens et ses perroquets. Il était rentré par Séville. Je suis rentré par Cordoue et par la Galice. Au passage, j’ai embarqué Gongora, Valle Inclan et Rosalia de Castro. Dejadme llorar, orillas del mar… Et tous les autres ont suivi. Ils ont nourri par le plaisir mon métier de journaliste. J’ai pas mal écrit sur les livres et les auteurs que je découvrais, que j’aimais. Je n’ai pas écrit sur ceux que je n’aimais pas. Certains écrivains sont devenus des amis. Je crois pouvoir dire que je ne les ai rejoints qu’en passant par l’enfance, et en y restant.
Après l’attentat du 7 janvier 2015, dans ma chambre d’hôpital, l’un des livres que j’ai demandé à ma famille était un recueil des poèmes de Quevedo qui se trouvait dans ma bibliothèque. Quevedo est épouvantablement sarcastique et la bonté n’est pas une de ses qualités. Mais sa langue m’a, comme tant d’autres, longtemps intoxiqué. Je le lisais volontiers en buvant à Madrid mon café au lait dans le quartier de La Latina. C’est Borges qui me l’avait fait aimer. Je voulais retrouver ses grimaces et ses enchantements baroques au moment où je ne cessais de descendre au bloc, à la fois immobilisé et défiguré –comme exilé de ma propre vie. Je voulais lire et relire ce poème écrit «depuis la tour», Desde la torre, autrement dit la Torre de Juan Abad, village où il fut exilé en 1620: Retirado en la paz de estos desiertos,/ con pocos, pero doctos libros juntos,/ vivo en conversación con los difuntos/ y escucho con mis ojos a los muertos. Je traduis à peu près : Retiré dans la paix de ces déserts,/ avec peu de livres, mais savants,/ je tiens conversation avec les défunts,/ avec les yeux j’écoute les morts. J’aurais préféré traduire le troisième vers par : Je fais causette avec les défunts, mais c’est trop familier pour un poète du Siècle d’or, un homme qui, lorsqu’il veut dire trou du cul, parle de troisième oeil. On n’était pas moins agressif que Henry Miller à cette époque-là en Espagne, mais on était moins familier –moins naturel, dirait-on aujourd’hui. Traduit comme on le voudra, ce poème fut en tout cas mon état d’esprit, ou à peu près, pendant quelques mois d’hôpital. Le peu de livres qui m’accompagnaient n’étaient pas savants, ils m’étaient simplement chers. J’ai perdu celui de Quevedo dans un déménagement, dans un carton, entre deux chambres. Je ne l’ai toujours pas racheté. J’hésite.
Philippe Lançon
Qui sommes-nous?
Thierry Clermont est journaliste au Figaro littéraire depuis 2005. Il a été membre de la commission poésie du Centre national du livre....
SUITE
Interview
Diplômé de l'École Normale Supérieure et spécialiste des lettres modernes, de l'espagnol et de l'anglais, Clément Ribes....
SUITE
Rechercher
Catégorie

QUI SOMMES-NOUS?
Bienvenue sur le site de New Spanish Books, un guide des...