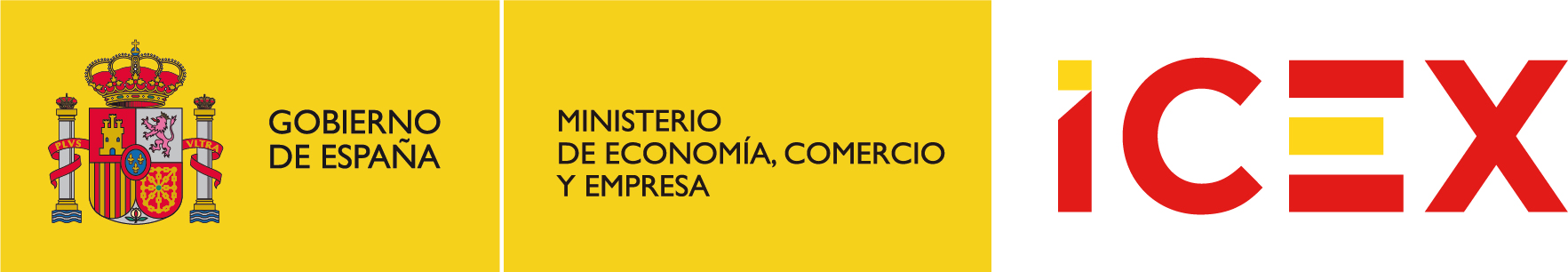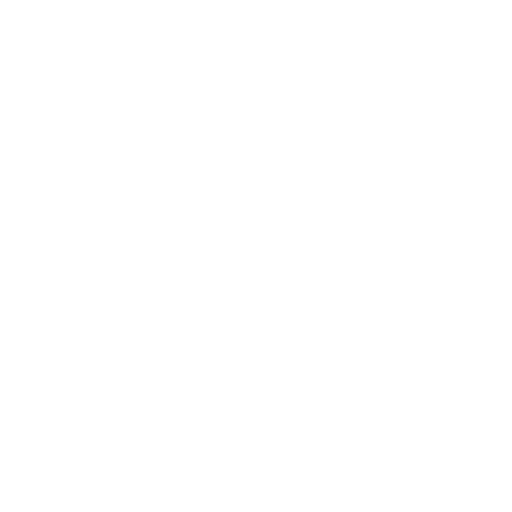Les traducteurs – ceux pour qui la traduction n’est pas une simple opération technique – ont du mal à recevoir de manière simplement passive, sans donner d’eux-mêmes, sans partager. Quand ils lisent, ils ont des fourmillements dans les doigts, une envie irrépressible de jouer avec les mots, d’étudier leurs associations, de faire entendre la petite musique que les paroles chantent dans leur tête. Ils ont aussi su rester des enfants qui ouvrent le ventre de leurs jouets pour voir comment ils fonctionnent, qui les démontent et remontent au risque de tout casser. Les dévêtir pour les rhabiller. Les tuer pour les ressusciter, les rendre plus beaux, plus personnels, les customiser, se les approprier et partager avec jubilation le résultat. Pour expliquer ce que je fais, traduisant, j’use de métaphores. Cette expérience me semble plus vraie, ainsi exprimée, que si je passais par une description savante ou que si j’employais le langage des traductologues, cette engeance honnie qui m’est ce que les commentateurs poussifs sont aux athlètes. L’essentiel est là : Lire + (Écrire x Partager) = Traduire.
Après, tout est possible. L’éventail des possibilités est immense depuis la traduction-calque, telle que celle de la bible pratiquée au Moyen-Âge en Espagne, à la plus libre recréation à la mode au XVIIe siècle par La Fontaine réinventant Esope et Phèdre ou La Bruyère adaptant Théophraste aux mœurs de son siècle. De grandes différences de points de vue, de postures existent entre ces écrivains de l’ombre, à qui il serait inconvenant de demander des comptes comme à des étudiants de licence qui ne traduisent que pour montrer à leur professeur qu’ils ont compris. En traduction, la trahison n’est pas dans le contresens, le faux sens, l’inexactitude occasionnels, mais dans le résultat. Il suffit que la traduction, devenue autonome, confère un droit d’entrée dans la littérature de la langue qui l’accueille et remplisse sa mission.
La capacité à relever ce défi tient à l’histoire personnelle, toujours déterminante, aux rencontres, à la filiation, à l’amour… Nul besoin d’avoir l’original en regard pour juger de la valeur d’une traduction. Dans celle qui fait vibrer le lecteur, il reste forcément quelque chose qui vient de loin que l’on pourrait questionner : ce passage d’une langue à l’autre heureuse ou malheureuse est une initiation, une traversée et une « opération d’amour », pour reprendre le titre d’une traduction de Jacques Ancet d’un recueil de Juan Gelman.
À ce sujet, je me souviens d’une conversation avec Jean Portante, formidable passeur lui aussi de l’œuvre de Juan Gelman, sur la place du traducteur par rapport à l’auteur. Un jour où je lui expliquais que, pour ma part, j’essayais de m’imaginer ce que l’auteur aurait écrit s’il l’avait fait dans ma langue au point de chercher à m’effacer, voire de rêver de traductions que je ne signerais pas et qui se contenteraient du nom de l’auteur, il me répondit en forçant le trait : « Eh bien, pour moi, c’est le contraire : quand je publie l’une de mes traductions, je me demande pourquoi on conserve le nom de l’auteur de l’œuvre originale : sur la première de couverture le nom de Jean Portante suffirait. » Il va de soi, que pour lui la traduction se trouve quelque part entre la parole de l’autre et celle de soi, qu’elle est une « baleine », qui ressemble au poisson sans en être un. Traduire suppose évidemment un travail d’appropriation de quelque chose qui n’est pas soi avant de le devenir. Mon désir de disparaître, de m’effacer est, tout au plus, un horizon vers lequel je tends, en réalité une illusion. Si Portante traducteur reste Portante auteur, si l’écrivain en lui porte son Gelman sur les épaules, formant un continuum avec son hôte, pour ma part, je donnerais plutôt voix à des hétéronymes ; je sais au fond que mes auteurs ne s’appartiennent plus vraiment, ils portent chacun une de mes voix, certes, toujours différente ; la leur est-elle moins audible, quand je ne suis jamais autant moi-même que lorsque je feins d’être cet autre ?
Tout se noue, tout se joue dans l’expérience des langues, dans ce passage d’un idiome à l’autre, et, en ce qui me concerne, au sein de l’espace roman, où l’intercompréhension naturelle, partielle, jamais aboutie, me permettait enfant de toujours saisir quelque chose de l’altérité qui s’offrait et m’échappait. Figuration de l’expérience amoureuse, j’aime sentir vibrer dans la traduction un battement qui ressemble à la vie. Ainsi ai-je l’impression d’avoir toujours traduit, d’abord des bribes de phrases d’une langue à une autre, puis à l’occasion d’exercices scolaires : de laborieuses traductions latines ou grecques au lycée jusqu’à l’agrégation, puis d’élégantes versions anglaises en khâgne auprès d’une exigeante Melle de Chaumont.
Cependant, c’est surtout l’expérience de la poésie et le va-et-vient continuel de ma balbutiante création en corse à sa traduction française « pour voir ce que ça donne, quand on réduit le texte à son signifié », qui a forgé ma vocation de traducteur. L’auteur, qui se laisse séduire par la langue, prend parfois des risques. Traduire son propre texte est en quelque sorte le mettre à nu, l’écorcher vif avant de lui donner une nouvelle peau. C’est se dire à certains moments « ne te laisse pas séduire par les attraits de ce mot, qui ne dit rien de plus ni de mieux que ce que tu veux signifier ». De la traduction de soi, je suis un jour passé à celle d’autrui sur les conseils de mon ami le poète Guillevic, lui-même auteur d’une belle anthologie de poètes hongrois, qui, en français, m’avaient semblé tous écrire comme Guillevic.
À côté de quelques essais dans le domaine italien, sur de nouvelles d’Erri de Luca, pour la revue Levant, ma première expérience en espagnol date de 1990. À cette époque, ma connaissance de cette langue était parcellaire. Je m’étais familiarisé avec sa proche parente portugaise à l’occasion d’un long séjour dans un village de la Beira Alta. Trois années d’espagnol au lycée, quelques séjours à Palma de Majorque, dix ans de fréquentation du judéo-espagnol à Istanbul, la lecture de quelques textes philosophiques de Miguel de Unamuno en langue originale achetés quatre sous chez un bouquiniste du quartier latin, ou la traduction espagnole des Fondements de la métaphysique des Mœurs d’Emmanuel Kant, prêtée par une camarade franco-catalane convaincue que la traduction espagnole était plus intelligible que la française, bref, assez de bribes et d’intuition pour lire un roman, un poème, mais des rudiments insuffisants pour me lancer bille en tête dans cette entreprise périlleuse.
Les choses sérieuses commencent quand le Centre d’Action Poétique (1976-1996), fondé à Paris par Monique Royer, ouvre la crypte de l’église de la Madeleine à des poètes de langue espagnole, notamment à l’occasion des Belles étrangères mexicaines. Je traduis un très long poème, au vocabulaire luxuriant, de José Luis Rivas, que vingt ans plus tard, je devais publier aux éditions du Noroît (Québec). Je dois aussi à Marie-Claire Zimmermann, professeur émérite de littérature espagnole et catalane, rencontrée dans ce même lieu, la découverte de la poésie espagnole contemporaine, notamment desnovíssimos, ainsi qu’à Ana María, alors étudiante en filología hispánica à Zaragoza, rencontrée à Florence un jour d’été 1990. De retour à Zaragoza, elle m’envoie quelques livres de poèmes, dont Poemas del manicomio de Mondragón de Leopoldo María Panero, accompagné d’un commentaire : Molto strano, però assai interessante, vedrai! À peine achevée cette première traduction, dans l’unique but de comprendre le texte, je rencontre, au Marché de la Poésie, Roger Lahaye dont j’avais entendu dire qu’il dirigeait une collection de poésie européenne, dans laquelle ne figurait encore aucun Espagnol. Il feuillette quelques pages, et il décide immédiatement de publier le recueil.
Commencent alors dix ans de traduction de poésie, avec une anthologie bilingue de cinquante poètes espagnols et hispano-américains pour Revista Atlántica de Poesía, avant de passer souvent du français ou d’autres langues en espagnol, jusqu’au jour où sur la recommandation de Jacques Ancet, André Dimanche me demande de traduire un roman,El hombre perdido de Ramón Gómez de la Serna, opération risquée mais pas sans filet grâce aux relectures de traducteurs comme Jacques Ancet, Bernard Sesé ou Henry Gil. Au cœur de la pléiade de traductions qui vont suivre, il faut accorder une place particulière au catalan. Jesús Fernández Palacios m’avait demandé de traduire en français quelques poèmes catalans et galiciens, pour le tiré à part du numéro 8 de Revista Atlántica qu’on devait présenter à Paris, et devant mon refus de traduire de l’espagnol, j’entrepris de lire l’original catalan jusqu’à le comprendre. Cette découverte sera à l’origine de la traduction intégrale de l’œuvre de Jaume Pont, le poète catalan à mon sens le plus remarquable des quarante dernières années, mais aussi de recueils de poètes comme Pere Gimferrer, Carles Duarte, Francesc Parcerisas, Antoni Clapés ou Cèlia Sànchez-Mustich.
Vient un moment où traduire risque de devenir une douce routine. « Selon ma femme, chaque soir je reprends mon tricot », m’a confié un soir le traducteur argentin Rolando Costa Picazo, avec qui je partageais une table ronde sur « Borges, traducteur » à l’institut Cervantes de Paris. Pour y échapper, je passe d’une langue romane à l’autre, j’aime traduire dans la distance et la proximité, traducir, traduzir, traduir, tradurre, traducia… je voyage dans l’espace roman essentiellement entre l’espagnol péninsulaire, et de plus en plus hispano-américain (Piglia et Toscana), le catalan (Pont, Serés et Palol) et le corse du nord au sud (Dalzeto, Di Meglio, Thiers…), parfois le latin (Savelli) et le portugais (Rosa Alice Branco), sans oublier quelques échappées brèves, le plus souvent, en arabe (Maram el-Masri), en hébreu (Rony Somek), en turc (Enis Batur) et tout récemment en sarde (Anna Cristina Serra) et en grec (Vassilis Vassilikos, Yannis Ritsos). De telles équipées ne se mènent pas seul, elles sont l’occasion de partages, de rencontres avec les auteurs, avec d’autres traducteurs amis, avec les éditeurs, avec les lecteurs.
Qui sommes-nous?
Thierry Clermont est journaliste au Figaro littéraire depuis 2005. Il a été membre de la commission poésie du Centre national du livre....
SUITE
Interview
Diplômé de l'École Normale Supérieure et spécialiste des lettres modernes, de l'espagnol et de l'anglais, Clément Ribes....
SUITE
Rechercher
Catégorie

QUI SOMMES-NOUS?
Bienvenue sur le site de New Spanish Books, un guide des...