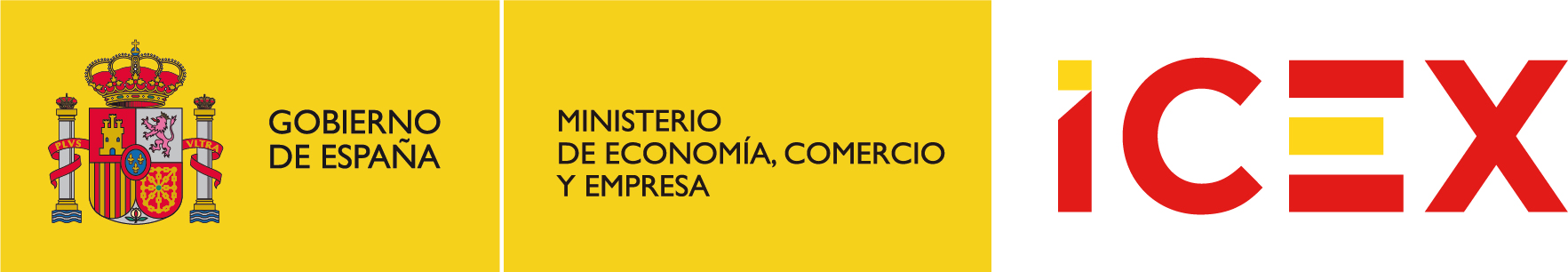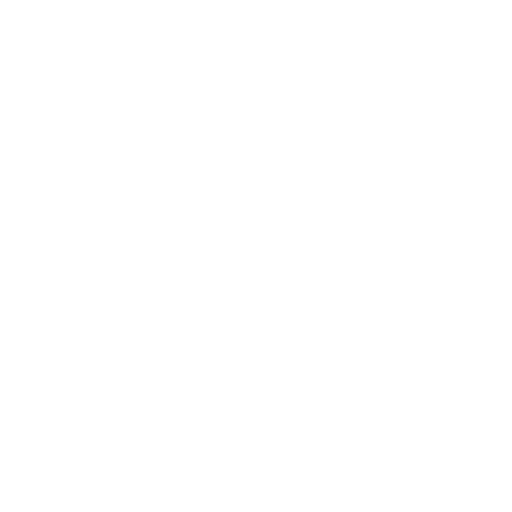Après avoir enseigné le français au Mexique, René Solis a été longtemps journaliste au service "culture" du quotidien Libération dont il a dirigé la rubrique "théâtre". Parallèlement, il a depuis 1990 poursuivi une activité de traducteur de littérature espagnole, principalement d'Amérique latine. Il a introduit en France le Mexicain Paco Ignacio Taibo II. Il traduit aussi des auteurs cubain (Leonardo Padura), colombien (Jorge Franco), argentin (Pablo de Santis) , salvadorien (Horacio Castellanos Moya), parmi beaucoup d'autres. Il intervient aussi dans les ateliers de l'École de traduction littéraire créée en 2012 sous l'égide du Centre national du livre. Il fondé en 2015 la revue culturelle en ligne délibéré.fr
De la Sierra Madre aux Pyrénées
La première phrase que j’ai prononcée en espagnol, je l’ai construite à l’aide de la méthode de langue qui était dans ma valise. J’étais à l’aéroport de San Juan de Porto Rico, devant le comptoir d’une compagnie d’aviation mexicaine. J’avais un billet pour Mérida dans le Yucatan et je souhaitais changer ma réservation et prendre un vol direct pour Mexico. La phrase, que j’avais longuement répétée, était correcte: -“Tengo un billete para Mérida y quisiera un billete para México”- et ma prononciation suffisante pour que l’employée au guichet me réponde dans la même langue. C’est alors que j’ai ouvert de grands yeux perplexes: ne parlant pas un mot d’espagnol, je n’avais logiquement pas compris un mot de sa réponse. Je me suis senti encore plus bête quand mon interlocutrice m’a lancé d’un ton agacé: «Why the hell dont you speak english?». C’est donc en anglais, et le rouge au front, que j’ai changé mon billet.
Il est possible que ce traumatisme originel ait joué un rôle déterminant dans mon rapport à la langue espagnole. Débarquant ce même jour à l’aéroport de Mexico, j’étais résolu à tout mettre en œuvre pour effacer l’humiliation. J’avais grandi en France, fait du russe et du latin au collège et au lycée, vécu presque un an aux Etats-Unis; je parlais correctement l’anglais; je n’avais jamais mis les pieds en Espagne ou en Amérique latine et j’ignorais tout de l’espagnol.
Je me suis jeté à l’eau sans savoir nager. Tout était bon, les journaux -au moins deux par jour-, la radio, la télé, et les conversations saisies dans la rue. Plus, le soir, la fameuse méthode. Totalement immergé dans la langue, j’ai l’impression de l’avoir apprise par capillarité. La musique a joué un grand rôle: l’accent mexicain, à la fois lent et chantant, se prêtait à l’imitation; je répétais des phrases sans en saisir le sens mais avecle souci d’en reproduire l’intonation. Bref, au bout de quelques semaines -bien plus vite en tout cas que les «90 jours» mentionnés sur la couverture de la méthode-, j’étais capable de tenir une conversation simple et je n’allais pas tarder à passer des journaux aux livres.
Plus que de l’apprentissage, cela tenait de la passion amoureuse, je dévorais tout, mots et images, langue et pays confondus, amoureux du Mexique et de ses habitants, autant que de l’espagnol. Une passion jalonnée de premières fois: les premières rencontres, la première dispute en espagnol, le premier rêve en espagnol, et bien sûr le premier livre en espagnol, comme la confirmation de la renaissance contenue dans mon prénom: j’étais bel et bien «re-né» en espagnol.
Vivant au Mexique, la littérature latino-américaine a été le premier vivier. Carpentier, Cortazar, Borges, Vargas Llosa, Rulfo, Onetti… je retrouvais la boulimie de lecture de mon enfance et du début de mon adolescence. C’est à l’occasion de ces toutes premières lectures qu’est née ma «vocation» de traducteur. Sous le signe de la colère. J’avais lu avec ferveur Sobre héroes y tumbas, le roman de l’Argentin Ernesto Sábato. Et je brûlais de le faire découvrir à mes amis français. Lors d’un voyage à Paris, j’ai fait le tour des librairies. Nulle trace du livre; pourtant je ne doutais pas qu’il avait été traduit. Internet n’existait pas, les recherches étaient un peu plus longues. Je me souviens encore de ma stupéfaction lorsque j’ai découvert le titre français d’un livre qui pour moi ne pouvait s’appeler que «Sur des héros et des tombes», tant le charme énigmatique du titre espagnol – qui ressemblait à un titre de chapitre de roman du XIXe siècle - me semblait directement transposable d’une langue à l’autre. Sauf que l’éditeur français avait préféré l’intituler Alejandra. La platitude de ce «choix» m’enrageait, j’y voyais un aveu de renoncement. Dès lors, j’avais la quasi-certitude que la traduction française du roman ne pouvait être que catastrophique. J’ignorais bien sûr à l’époque que les traducteurs n’ont le plus souvent pas leur mot à dire dans le choix des titres, chasse gardée de l’éditeur. Et de rage, j’ai entrepris de retraduire le premier chapitre de Sobre héroes y tumbas. Ma tentative n’a pas dû aller très loin -je n’en ai pas retrouvé trace dans mes papiers-, j’ai sûrement rapidement mesuré que la tâche n’était pas si simple. Mais j’avais sans le savoir, fort de l’illusion que je serais meilleur traducteur que le traducteur, mis la main dans l’engrenage.
Quelques années encore, et je faisais mes débuts. L’un des tout premiers textes qu’un éditeur m’a demandé de traduire était signé… Pablo Neruda. Ce n’était pas très long, quelques pages sur Valparaiso, inédites en français, destinées à accompagner un petit livre de photos de Sergio Larraín. Naïveté, inconscience, outrecuidancedu débutant? J’avais hésité, puis fini par accepter. Je crois bien que j’ai passé plusieurs semaines sur cette dizaine de pages, miné par l’idée que je n’étais pas à la hauteur. J’ai fini par rendre mon travail. Quelques jours plus tard, encore taraudé par l’inquiétude, j’ai feuilleté l’édition française de J’avoue que j’ai vécu (Confieso que he vivido), l’autobiographie de Neruda. Et j’y ai trouvé le texte «inédit» sur Valparaiso! Claude Couffon, traducteur émérite de l’œuvre du poète, l’avait traduit des années avant moi… Je crois que je n’ai même pas osé comparer nos deux versions et j’ai aussitôt appelé l’éditeur, convaincu qu’il renoncerait immédiatement à publier la mienne. Mais il m’a assuré que ce que je lui avais remis lui convenait. Et le livre est paru, sous le titre Valparaiso, avec ma traduction. Il y a quelques mois, un autre éditeur a entrepris de rééditer ce Valparaiso, introuvable depuis longtemps. Vingt-cinq ans après, j’ai relu ma version, en regard de celle de Couffon. Je ne dirais pas que la mienne est meilleure, mais elle tient la route.
J’avais découvert l’espagnol au Mexique, vécu des années en Amérique latine: presque naturellement, j’ai surtout traduit des auteurs du continent américain. Mexique, Cuba, Salvador, Venezuela, Colombie, Pérou, Chili, Argentine, Uruguay: la carte littéraire des pays que j’ai visités s’est peu à peu étoffée. Restait un regret, presque un complexe: l’Espagne, terra incognita…
Incroyable mais vrai, j’ai traversé des dizaines de fois l’Atlantique avant de franchir les Pyrénées. Mes premières incursions n’ont pas été simples. Quand j’ouvrais la bouche, moi qui pouvais me vanter de parler l’espagnol sans presque faire de fautes, je lisais la surprise ou le sourire sur le visage de mes interlocuteurs: ce Français s’exprimant comme un Mexicain avait tout de la bête curieuse. Ce n’était pas seulement l’accent qui me faisait défaut, mais les références culturelles, l’expérience du quotidien, les modismes, l’argot, les codes… J’avais parfois l’impression de me retrouver trente ans en arrière, à l’aéroport de San Juan de Porto Rico, devant le comptoir de la Mexicana de Aviación.
Comme souvent, la lacune à combler s’est transformée en revanche à prendre. Je suis allé en Espagne de plus en plus fréquemment, avec de plus en plus de plaisir, comme si je voulais rattraper le temps perdu. Ne restait qu’une épreuve pour me sentir enfin légitime: la traduction d’un roman espagnol. Baptême brutal mais formidable: Las niñas perdidas (titre français, Deux petites filles) de Cristina Fallarás, course folle dans les bas-fonds de Barcelone carburant à la rage et à l’humour noir. J’en suis sorti ému, heureux, groggy, avec le sentiment d’avoir enfin rejoint le lieu des origines, d’être rentré à la maison.
René Solis
Qui sommes-nous?
Thierry Clermont est journaliste au Figaro littéraire depuis 2005. Il a été membre de la commission poésie du Centre national du livre....
SUITE
Interview
Diplômé de l'École Normale Supérieure et spécialiste des lettres modernes, de l'espagnol et de l'anglais, Clément Ribes....
SUITE
Rechercher
Catégorie

QUI SOMMES-NOUS?
Bienvenue sur le site de New Spanish Books, un guide des...