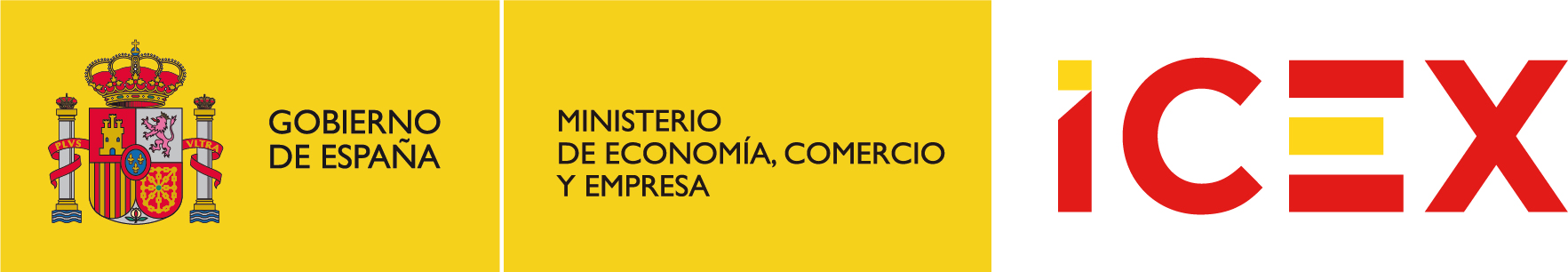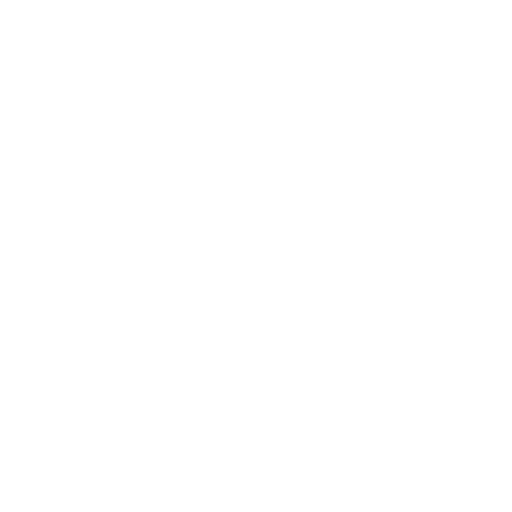Auteur: Mariano PEYROU
Lecteur: Eric Reyes
C’est dans l’intimité du bar La Pandora que les trois amis ont pour habitude de se retrouver le jeudi soir : Garzía, Amundsen et le narrateur, un « je » malicieusement privé de nom dans un livre qui, comme indiqué, s’essaye à déceler Les noms des choses. L’occasion pour ces quadras madrilènes de se réunir autour d’une conversation, de goûter à l’exposition sensible du vécu et du ressenti, d’échanger leurs impressions ou de se couper la parole sans ménagement, de se perdre dans les plaisirs de la discussion, de la causette, de la spéculation, des échanges en tout genre, du moment que l’on touche à l’émergence douce des doutes et des craintes, aux taquineries charitables de l’amitié, faisant alors éclore un livre délectable par sa forme et bienveillance. Car le roman de Mariano Peyrou, tout en énonciation, parvient à tisser une trame dans l’immédiateté de la parole directe, du discours sur l’autre, et de ses corollaires qui sont le dialogue, la contradiction, la communion.
Ces trois-là sont respectivement cinéaste, écrivain et employé d’un ministère, ou bien, suivant une autre forme de catégorisation, le père d’une petite fille et compagnon d’une éditrice néerlandaise ; un séducteur compulsif, entourés d’« amies », mariées de préférence, mais quand même un peu amoureux d’une Argentine franc du collier ; un homme qui a l’impression de ne pas connaître sa femme et père d’un garçon de huit ans dont les saillies linguistiques et les fulgurances cognitives font les délices de cette joyeuse compagnie.
Ainsi, on questionnera tour à tour l’arbitraire des couleurs, les embûches de la polysémie, la duplicité des métaphores, le travestissement des proverbes, les injustices de la toponymie… autant d’étonnements auxquels nous convie ce cheminement ludique et poétique, privé et universel, ordinaire comme la vie, géniale dès lors qu’on s’y attarde tant soit peu.
Très vite nous comprenons que les appellations sont aussi relatives que fuyantes, ou « déictiques », à savoir qu’elles ne se parent d’un sens qu’en fonction du contexte d’énonciation. Autrement dit : entre l’individu et les noms qu’il emploie se noue un rapport affectif et esthétique intime, une façon unique d’être au monde. Ou comme le formule l’un des personnages : « Les choses se cachent derrière un nom. Il faudrait les en dépouiller, les mettre à nu. Débusquer leurs autres noms. »
Empruntant son rythme au comic strip (il y a indéniablement quelque chose de Mafalda et de Monsieur Jean dans ce livre) dont il partage la brièveté, la parole scénarisée, et la chute conçue comme un effondrement — ou renversement — épistémique, l’enchaînement de situations, sorte d’alignement de vignettes dans un album (avec ses personnages récurrents et ses dialogues), s’appuie sur une composition capable de circonscrire les épisodes à leur unicité tout en empochant les gains sur le long cours. C’est alors qu’on parvient à délier un nouvel usage du langage, à rebattre un lexique qui s’émancipe au fil des pages, mais également à construire une pensée contemporaine, laquelle, prenant l’actualité par son bout sémantique, interroge les nationalismes (dans le contexte catalan notamment), les luttes identitaires (avec cette « fierté » exubérante qui est aussi une porte ouverte à la « honte »), et en filigrane une nouvelle masculinité dont il est du ressort de ces jeunes parents d’en tracer les contours.
En attendant, ce sont les grands thèmes de la maturité naissante qui font la matière des conversations dans ce livre : la construction de soi, le choix de la vie à deux, les défis de la transmission et de la protection, le bon usage de la liberté, et surtout l’angoisse de la mort, celle de ses parents vieillissants et la sienne propre, ou pour reprendre les propos d’Amundsen l’écrivain: « On ne saurait écrire sur rien d’autre que la mort. Il n’y a pas d’autre sujet. » Symboliquement, c’est par ce mot que s’achève le livre…
Bien que parfois à contre-courant des sursauts actuels de l’opinion publique, car attaché à complexifier et démystifier la langue, prenant ainsi le contrepied des slogans et d’une certaine tendance à l’étiquetage, et pouvant parfois s’aventurer dans l’histoire récente espagnole (mais n’est-ce pas là aussi l’intérêt d’une traduction ?), le dernier roman de Mariano Peyrou est surtout un fabuleux essai sur les rapports ternaires, clé d’accès aux douceurs du monde, ou comme il est pressenti au sujet des trois amis : « Nous sommes le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; la thèse, l’antithèse, la synthèse, le ça le moi et le surmoi ; l'infrastructure, la structure et la superstructure ; La Terre, la Lune et le Soleil ; le passé, le présent et le futur ; la faim, la soif et la satiété. »
Une lecture gratifiante du fait de son renouvellement constant et de ses embardées érudites, salutaire par son approche nominaliste d’un monde parfois trop catégorique.
Eric Reyes Roher 30/06/2020
Qui sommes-nous?
Thierry Clermont est journaliste au Figaro littéraire depuis 2005. Il a été membre de la commission poésie du Centre national du livre....
SUITE
Interview
Diplômé de l'École Normale Supérieure et spécialiste des lettres modernes, de l'espagnol et de l'anglais, Clément Ribes....
SUITE
Rechercher
Catégorie

QUI SOMMES-NOUS?
Bienvenue sur le site de New Spanish Books, un guide des...