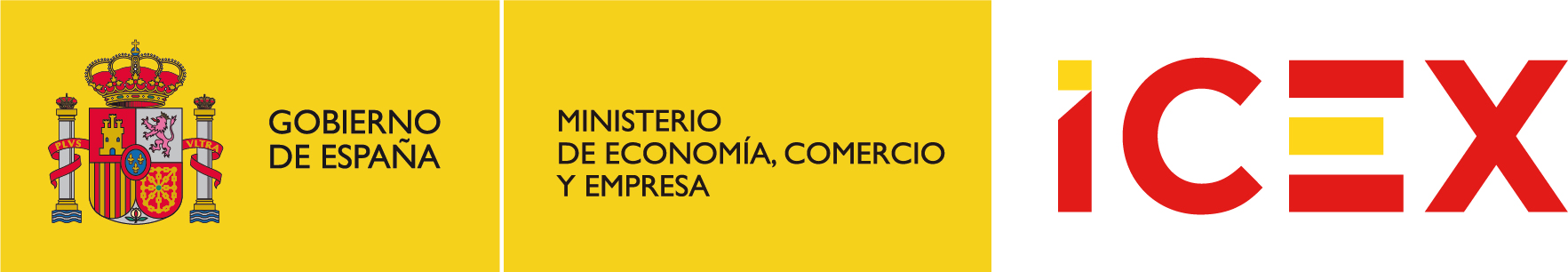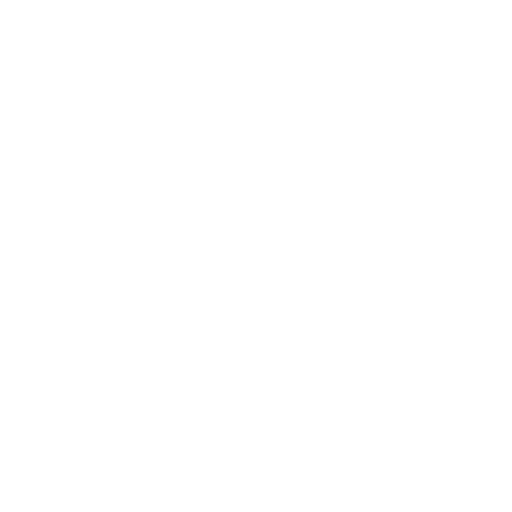Isabelle Gugnon a vécu au Chili et en Argentine. De retour en France, elle a monté une petite agence littéraire et a commencé à traduire avant de travailler aux éditions Hazan, de faire un court passage en tant que directrice de collection aux éditions du Seuil, pour revenir aux sources et se replonger exclusivement dans la traduction. Elle traduit entre autres auteurs Rodrigo Fresán, Juan Gabriel Vásquez, Carmen Posadas, et s’apprête à rendre en français les prochains romans d’Antonio Muñoz Molina.
Carte blanche
Originaire de l’Est de la France, je n’avais a priori aucune raison d’avoir un jour une relation de tous les instants avec la langue espagnole. C’est d’abord le pays qui est venu me frapper comme une révélation à dix ans, l’année de la grande sécheresse, lors d’une traversée en voiture pour aller passer des vacances en famille dans le Sud. J’ai été séduite par des détails qui font aujourd’hui figure de clichés : le passage difficile des Pyrénées, les routes de Castille sèches comme des paillassons, les villages écrasés de soleil d’où ressortaient une église, un cimetière, un café, les hôtels ancrés dans les années 1950 et 1960 jusque dans la typographie de leurs enseignes, les melons jaunes et verts alors introuvables dans ma région, les beignets de calamar arrosés de citron, la saveur des polvorones, ces petits gâteaux à l’huile d’olive, les femmes en noir assises devant les murs chaulés. Tout cela me semblait à la fois d’un exotisme et d’une austérité sans pareils. Le péninsule ibérique s’est ensuite rappelée à moi quand j’ai commencé à en apprendre la langue lors de séjours à Madrid, et dès l’âge de quinze ans, les cours d’été à l’université m’ont fait découvrir la littérature du Siècle d’Or, en particulier Quevedo, que je promène toujours aujourd’hui avec moi, et les poètes de la Generación del 27. Les séjours dans la capitale espagnole se sont multipliés, studieux dans la journée, plus dissipés le soir, dans les bars de la movida, tout aussi riches d’enseignement que les livres. Sans faire dans la dentelle, j’ai commencé à lire tous azimuts en écoutant du flamenco, sans respecter aucun ordre, et dévoré l’œuvre de Muñoz Molina, Juan Marsé, Mendoza. Très vite, les monstres latino-américains sont venus colorer ma bibliothèque : García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, et le coup de massue de la littérature argentine, avec Borges, Cortázar, Bioy Casares, Silvina et Vitoria Ocampo, Arlt, Piglia, Puig, Soriano, Sábato, Saer.
Après des études d’espagnol à la Sorbonne, il devenait évident que mon travail serait lié à cette langue, mais je n’avais pas la fibre professorale. Au gré de CV envoyés au petit bonheur la chance, je me suis retrouvée à écrire dans un quotidien bolivien, puis j’ai monté une minuscule agence littéraire à une époque où les éditeurs rechignaient à acquérir via une Française les droits d’auteurs étrangers. L’agence vivotait cependant, elle m’a permis d’introduire des auteurs argentins comme Rolo Diez, Juan Damonte, Juan Sasturain, José Pablo Feinmann à la Série Noire et, surtout, de voyager dans le Cône Sud et de commencer à traduire. Je n’ai plus arrêté, avec une préférence pour l’espagnol singulier d’Argentine, la richesse stylistique d’auteurs en compagnie desquels j’ai refait le monde sur les toits aménagés de Buenos Aires : Fernanda García Lao, Ricardo Romero, Rodolfo Fogwill, Federico Jeanmaire, Samanta Schweblin, Pola Oloixarac, Eduardo Sacheri.
De cette époque date l’irruption dans mon petit parcours de deux auteurs que j’ai regardés de plus ou moins près, ignorant qu’ils allaient devenir essentiels. J’ai croisé à vingt-cinq ans, dans une librairie-café de Buenos Aires, Rodrigo Fresán, qui venait de publier son Histoire argentine fracassante, déroutante, provocatrice. Je l’ai écouté, fascinée, avant de le lire, transportée, comme si j’avais affaire à un ovni littéraire, une expérience qui s’est reproduite par la suite avec Mantra, le livre qui l’affranchissait de sa condition d’Argentin pour faire de lui un expatrié revisitant Mexico DF. Impressionnée, je me suis gardée de l’aborder. J’étais loin d’imaginer que douze ans plus plus tard nous échangerions des mails quasi quotidiens et que j’allais rendre en français Les jardins de Kensington, puis le reste de l’œuvre gigantesque de ce formidable auteur qui est presque un Américain, mais pas tout à fait, et emporte ses lecteurs dans un tourbillon métalittéraire. Il fait désormais partie de ma vie, m’entraîne dans des lectures périphériques qui me ravissent et que je n’aurais peut-être pas choisies si elles n’étaient un passage obligé avant de le traduire ; il imprime un tournant résolument anglo-saxon à la fois livresque, musical, cinématographique à mes connaissances et me pousse à travailler dans une sorte de vertige.
La deuxième rencontre s’est faite à Paris, un jeune homme pas encore écrivain était venu dîner, je l’ai trouvé timide et gentil, il entamait des études littéraires à Paris. C’était Juan Gabriel Vásquez, dont le deuxième roman, Histoire secrète du Costaguana, m’a enchantée comme n’ont cessé de le faire depuis tous les livres qu’il écrit. Vásquez me relie lui aussi à la langue anglaise, sans doute de manière plus classique que Fresán, mais il parle également à merveille le français, ce qui nous permet de parvenir avec une grande précision à rendre certains passages difficiles. Traducteur de Conrad, il sait que pour donner toute la mesure d’un texte littéraire dans une langue, il faut parfois introduire de « belles infidèles », ces légers faux-sens qui trahissent pour mieux respecter le style dans son ensemble. Avec cet auteur, on pénètre dans l’histoire, secrète ou non, de la Colombie, ou plutôt les distorsions qu’on peut en faire, toutes époques confondues. Là encore, de même que pour Fresán, les inspirateurs sont anglo-saxons et s’appellent Conrad, Foster, Greene, bien que Vásquez se centre exclusivement sur son pays dans ses récits.
Ces expériences latino-américaines m’ont peu à peu éloignée de l’Espagne, et je le déplorais, mais la chance m’a souri et je me suis attelée cet été à la traduction d’Ordesa, de Manuel Vilas, une autofiction où la mort des parents de l’auteur déclenche le mécanisme de la mémoire et fait renaître les rares souvenirs que ses géniteurs lui ont laissés. L’Espagne des années 1960 et 1970 y est constamment mise en parallèle avec celle des années 1990. Difficile de faire plus espagnol. Je me suis de nouveau glissée avec délice dans la langue de la péninsule, que je redoutais d’avoir perdue. Au fil des pages écrites par ce merveilleux écrivain qui est avant tout un poète, les images qui m’avaient captivée adolescente sont revenues par petites touches, et j’ai renoué sur le papier avec les passions de ma jeunesse, qui rejaillissent dès que je mets un pied dans n’importe quelle ville ou village d’Espagne.
Isabelle Gugnon
Qui sommes-nous?
Thierry Clermont est journaliste au Figaro littéraire depuis 2005. Il a été membre de la commission poésie du Centre national du livre....
SUITE
Interview
Diplômé de l'École Normale Supérieure et spécialiste des lettres modernes, de l'espagnol et de l'anglais, Clément Ribes....
SUITE
Rechercher
Catégorie

QUI SOMMES-NOUS?
Bienvenue sur le site de New Spanish Books, un guide des...