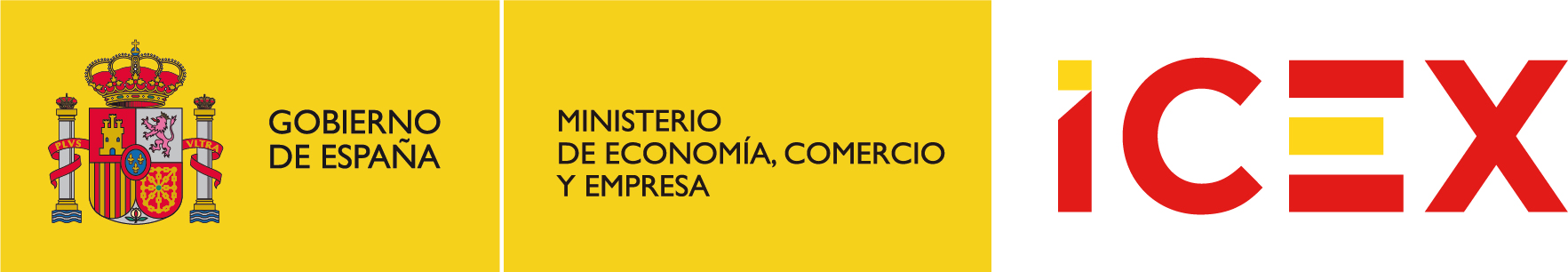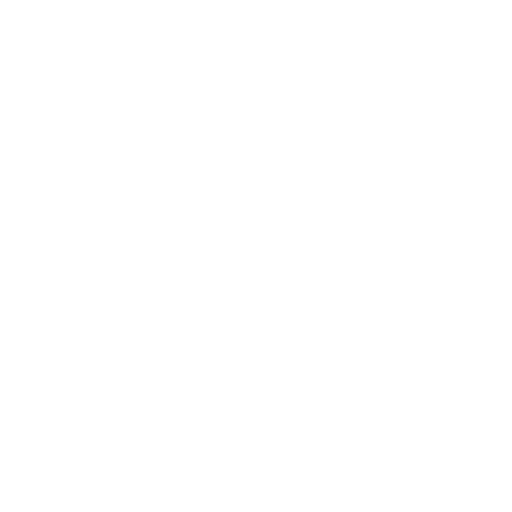Après huit ans passés aux éditions de l’Olivier, où elle a notamment initié un domaine hispanophone et publié des auteurs américains aux côtés d’Olivier Cohen, Nathalie Zberro a rejoint en mai 2013 les éditions Rivages pour diriger la collection de littérature étrangère et lui donner une énergie nouvelle.
Comment devient-on éditeur, et pourquoi ?
Je voulais être professeur de français depuis l’enfance, pensant que cela consistait uniquement à parler de livres que j’aimais, à les disséquer devant un groupe d’élèves. J’ai suivi un cursus très classique : bac L puis l’université, en littérature française et comparée. Une de mes amies a fait un stage chez Flammarion et j’étais tellement surprise qu’on puisse entrer dans une maison en envoyant une simple lettre, que j’ai tenté ma chance. L’édition me semblait un monde inatteignable. Je lisais des essais qui parlaient de l’âge d’or des années 70. Je trouvais les récits séduisants mais très éloignés de ma réalité : en fréquentantpar hasard tel café, ils avaient rencontré par hasard tel écrivain... Je viens d’un milieu social différent, où il faut provoquer la chance. Mais surtout l’époque a changé. Les parcours des trentenaires sont plus rectilignes, même si nos choix de lecteurs gardent leur singularité. Les détours que nos bibliothèques reflètent sont notre véritable formation. Et la mienne doit beaucoup à Agatha Christie, aux enseignants et à Bernard Pivot. Ses émissions ont fait entrer la littérature dans mon quotidien. Pas seulement le plaisir de la fiction, des histoires, que j’ai découvert à l’école, mais les écrivains, et tout ce qu’il y avait d’intime, de délicat (ou d’agaçant) derrière leur livre.
J’ai vraiment choisi de devenir éditrice après mon premier stage, il y a 12 ans. Au début, je manquais de lucidité, je construisais une figure de l’éditeur en artiste : seul dans son bureau, il aime un texte et veut le publier. Un peu comme l’écrivain est seul à sa table. Alors que le métier d’éditeur ne se conçoit que dans l’échange, le collectif. J’ai appris cela chez Verticales et à l’Olivier. Il y a toujours un plaisir égoïste, celui du simple lecteur, je ne le nie pas. Mais cette impression originelle doit être transformée. Et avant d’avoir un texte entre les mains, il faut avoir beaucoup lu, travaillé, parlé, convaincu. C’est une course d’obstacles.
Comment découvre-t-on un auteur étranger ?
Je ne sais pas si on découvre vraiment un auteur quand on est éditeur de littérature étrangère. Parce qu’on reste l’éditeur d’après. Même quand j’achète des manuscrits qui n’ont pas encore d’éditeurs dans leur pays, ce qui arrive pour les anglo-saxons, il y a eu des lecteurs avant moi : les agents. Ce sont des alliés précieux. Il faut aussi multiplier les enquêtes. Et exercer sa curiosité partout : lire la presse, les revues, les publications des maisons indépendantes, des éditeurs universitaires, rencontrer les confrères étrangers, écouter les conseils des traducteurs, etc. Souvent, on construit avec certains des relations privilégiées, qui nous guident vers tel ou tel texte. Une grande partie du travail est invisible. Et parfois inutile, tout en étant absolument nécessaire.
La littérature anglo-saxonne domine le marché français, comment l’expliquez-vous ?
Il y a bien sûr une raison économique simple : la littérature anglo-saxonne reste la plus vendue, donc la plus intéressante pour les maisons d’édition. Parce que les agents de ces pays sont plus puissants. L’autre explication possible est l’influence culturelle et historique de l’Amérique, qui domine encore symboliquement. Pour les baby-boomers, l’American Dream était le rêve absolu. L’Amérique demeure légendaire pour ma génération. Aux grands espaces sont venus s’ajouter les romans urbains mais la fascination continue. Pour caricaturer, je dirais qu’un dépressif à New York intéresse la terre entière alors qu’un dépressif à Santiago du Chili intéresse les chiliens. On accorde parfois inconsciemment plus de crédit à l’Amérique, parce que des auteurs, des cinéastes, des photographes venus de ce pays ont nourri notre imaginaire. Et c’est légitime, au fond. La réalité de la production est plus contrastée. La critique française idéalise parfois la littérature anglo-saxonne : elle a aussi son lot de romans médiocres qui ressemblent à des scénarii formatés. Pourtant, ces territoires restent d’extraordinaires lieux de découverte. Ils obligent simplement à être plus exigeants, plus audacieux et à savoir maintenir un certain cap – la fameuse « ligne éditoriale ». Par exemple, je viens d’acheter pour Rivages un premier recueil de nouvelles, Love, in Theory, écrit par une Américaine, E.J. Levy. Elle a été publiée par un petit éditeur (University of Georgia Press) et son livre n’est pas un best-seller. Mais je crois en son talent, proche de Lorrie Moore ou de Grace Paley : elle possède ce mélange rare de mordant et de grâce.
Est-il difficile de publier de la littérature hispanophone en France aujourd’hui ?
Oui, parce que les lecteurs ne cherchent pas spontanément un livre hispanique alors qu’ils réclament plus aisément un « bon roman américain ». Les écrivains du boom étaient des auteurs à succès mais les générations suivantes occupent une place plus modeste sur le marché. Alors qu’il y a de très grandes voix hispaniques et une variété plus évidente que dans la littérature anglo-saxonne, puisque le territoire est immense. Mais les littératures nationales sont moins organisées qu’en Amérique ou en Angleterre. Il y a moins d’agents, moins de passeurs : des initiatives comme New Spanish Books sont donc vitales.
J’ajoute que la célèbre étiquette du « réalisme magique » nuit peut-être aujourd’hui à la réception de la littérature hispanique. Parfois les lecteurs attendent un exotisme factice, ou des récits politiques exemplaires. La littérature hispanique a plus de deux dimensions, c’est sa force. Il n’y aucun rapport entre des auteurs comme Juan Francisco Ferré, Lucia Puenzo ou Alejandro Zambra. Pourtant ils parlent la même langue.
Quels sont vos projets pour la collection de littérature étrangère de Rivages ?
J’ai commencé ma mission de reconstruction il y a deux mois à peine : mon ambition est de recréer une dynamique. Il ne faut pas oublier que Rivages n’est pas seulement l’éditeur français de David Lodge. Dans le catalogue passé, on trouve Rick Moody, Erri de Luca, Javier Marías... Et des auteurs encore solidement ancrés à la maison comme Barbara Kingsolver. J’aimerais réactiver cette ambition littéraire. Mon projet s’articulera autour de nouvelles voix, bien sûr, mais je vais également faire un travail sur le fonds. La Bibliothèque étrangère regorge de pépites méconnues, comme Willa Cather. Depuis le rachat par Actes Sud, Rivages a maintenant les moyens stratégiques et intellectuels de redonner vie à la littérature étrangère, tant en grand format qu’en poche.
En 2015, nous publierons le dernier roman de Rafael Chirbes, En la Orilla, qui est un chef-d’œuvre et devrait consacrer enfin cet auteur en France comme il le mérite. J’ai également acheté deux livres écrits par de jeunes auteurs : un recueil d’E.J. Levy, déjà mentionné, mais également un roman d’Assaf Gavron, écrivain israélien prometteur. Le dernier projet en date me tient particulièrement à cœur : je vais rééditer toute l’œuvre de Bernard Malamud, un des plus grands écrivains juifs américains du XXe siècle, aux côtés de Philip Roth et de Saul Bellow. Nous allons d’abord publier un texte inédit en français, son premier roman, The Natural, qui est la quintessence du « Great American Novel » : Malamud dresse le portrait d’un génie du baseball qui devient à 30 ans, à l’âge où d’autres prennent leur retraite, le meilleur joueur du championnat, adulé de tous. Mais Malamud nuance cette trajectoire épique en faisant subtilement de ce héros idéal un personnage de roman russe, mélancolique et incapable de s’adapter au monde. Nous republierons, dans des traductions nouvelles ou révisées, ses autres romans (parus initialement au Seuil, chez Gallimard ou Flammarion) puis l’ensemble de ses nouvelles, qui le place dans la lignée d’auteurs comme Singer, Babel ou Cynthia Ozick.
Quel est votre auteur hispanique préféré ?
N’en choisir qu’un est impossible. Je vais me restreindre à trois noms : Vila-Matas, Bolaño et Onetti.
Recommandez-nous un livre…
"Crémation" de Rafael Chirbes; "La vie brève" de Juan Carlos Onetti et "L'Homme sentimental" de Javier Marías.
Et pour conclure… votre mot préféré en espagnol ?
"Preguntar", parce que le questionnement est le principe même de la littérature
Qui sommes-nous?
Thierry Clermont est journaliste au Figaro littéraire depuis 2005. Il a été membre de la commission poésie du Centre national du livre....
SUITE
Interview
Diplômé de l'École Normale Supérieure et spécialiste des lettres modernes, de l'espagnol et de l'anglais, Clément Ribes....
SUITE
Rechercher
Catégorie

QUI SOMMES-NOUS?
Bienvenue sur le site de New Spanish Books, un guide des...